Si d’autres indicateurs ont vu le jour, aucun ne semble taillé pour le remplacer.
L'actuariel 37
Trop centré sur la croissance et pas assez sur le social ou le développement durable, le PIB est accusé de ne donner qu’un reflet partiel de la situation d’un pays. Malgré les critiques, il continue toutefois de s’imposer comme l’alpha et l’oméga des politiques publiques.
Si les premiers travaux d’estimation du revenu national remontent au XVIIe siècle, c’est surtout après la grande crise de 1929 que le sujet fait l’objet de recherches plus approfondies. Aux États-Unis, l’économiste Simon Kuznets y travaille notamment pendant l’entre-deux-guerres et défend l’idée d’un revenu national devant avant tout être une mesure du bien-être. L’homme, souvent présenté à tort comme le principal architecte du produit intérieur brut (PIB), ne parvient toutefois pas à imposer sa vision lors de la mise en place de la comptabilité nationale pendant la Seconde Guerre mondiale et après. En effet, dès l’origine, le PIB a été conçu comme une mesure de l’activité économique et de la production, et non comme un indicateur de bien-être. Il prend toutefois une si grande ampleur qu’il en vient à être assimilé comme tel, surtout dans le contexte des Trente Glorieuses, où l’accroissement de la production se traduit par une amélioration du niveau de vie de la population. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que jaillissent les premières critiques. En 1968, peu de temps avant son assassinat, le sénateur américain Robert F. Kennedy regrette ainsi que le PIB tienne compte de « la pollution de l’air, de la publicité pour le tabac (…) et du coût des prisons », mais pas « de la santé de nos enfants, ni de la qualité de leur instruction ».
Développement durable, le grand absent
Au début des années 1970, les économistes américains William Nordhaus et James Tobin proposent, dans un article intitulé « La croissance est-elle obsolète ? », une « mesure de bien-être économique » qui exclut les éléments non générateurs de bien-être (trajets domicile-travail…) et intègre ceux qui y contribuent mais ne sont pas comptabilisés dans le PIB (travail domestique, bénévolat…). C’est aussi à cette période que paraît le rapport du Club de Rome qui alerte sur les limites de la croissance et sur les risques d’épuisement des ressources naturelles. « Ainsi naquit, il y a près d’un demi-siècle, ce que l’on nomme aujourd’hui “l’agenda au-delà du PIB” », souligne l’économiste Éloi Laurent dans son dernier livre (1). « La crise pétrolière de la fin des années 1970 a coupé court à ces réflexions, qui avaient été lancées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par les mêmes personnes qui avaient joué un rôle clé dans la mise en place du Club de Rome, rappelle Marco Mira d’Ercole, chef de la division des statistiques auprès des ménages et mesure du progrès à l’OCDE. Le climat politique avait changé et le discours s’est dès lors focalisé sur les questions plus traditionnelles de gestion de l’économie. » Alors que le chômage de masse fait son apparition, l’objectif de la croissance paraît d’autant plus important dans une perspective de création d’emplois. Les critiques ne disparaissent pas pour autant. À la fin des années 1980, le rapport Brundtland définit le concept de « développement durable » – un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs – avec ses trois piliers : économique, social et environnemental. De nombreux indicateurs alternatifs, visant soit à remplacer le PIB soit à le compléter, voient le jour au cours des années 1990 et 2000. L’un des plus célèbres est l’indicateur de développement humain (IDH), développé par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), qui combine PIB par habitant, espérance de vie et niveau d’éducation.
« Le PIB est un indicateur limité, incapable par construction de jouer un rôle d’alerte parce que c’est un indicateur de flux et non de stock »
Dominique MÉDA
Philosophe et sociologue, directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l’université Paris-Dauphine
Se fonder sur la valeur des actifs ?
En France, plusieurs voix se succèdent pour dénoncer les limites du PIB. « Je publie en 1999 Qu’est-ce que la richesse ?, où je propose de développer, à côté du PIB, d’autres indicateurs de richesse, rappelle la philosophe et sociologue Dominique Méda. Ces idées sont reprises et développées en 2002 par Patrick Viveret dans son rapport Reconsidérer la richesse et, en 2005, Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice publient Les Nouveaux Indicateurs de richesse. Nous avons montré dans ces différents ouvrages combien le PIB était un indicateur limité, incapable par construction de jouer un rôle d’alerte, parce que c’est un indicateur de flux et non de stock. » « Le PIB ne dit rien de l’évolution des patrimoines essentiels mobilisés pour fabriquer la production : le patrimoine naturel et le “patrimoine social”. Cette critique du PIB fait désormais l’objet de pages spéciales dans les manuels d’économie de terminale », poursuit Dominique Méda, également directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l’université Paris-Dauphine. Pour l’économiste Thomas Piketty aussi, « la notion de PIB traduit une vision centrée sur la production, sans souci pour la dégradation du capital (en particulier celle du capital naturel) ni pour la répartition des revenus et de la propriété », comme il le souligne dans son dernier ouvrage (2). C’est pourquoi « il est hautement préférable pour mesurer le bien-être économique d’un pays et de ses habitants d’utiliser la notion de revenu national plutôt que celle de produit intérieur brut », défend Thomas Piketty. Le revenu national net est égal au PIB corrigé des flux de revenus avec l’étranger et net de la dépréciation du capital. « Idéalement, il faudrait raisonner en net pour le revenu national ou le produit intérieur. Si les comptables nationaux ne mettent pas l’accent sur cette mesure, c’est parce que la dépréciation des actifs est mesurée de façon forfaitaire à partir d’hypothèses sur la durée de vie des équipements, et donc de façon peu précise », explique Didier Blanchet, directeur des études et synthèses économiques à l’Insee.
Une croissance mal estimée ?
L’agrégat phare de la comptabilité nationale, qui a déjà été réformé à plusieurs reprises (3), fait l’objet depuis quelques années d’un autre type de critiques, portant sur sa capacité même à bien mesurer l’activité. Plusieurs chercheurs, dont Philippe Aghion, professeur d’économie au Collège de France, avancent que la croissance serait sous-estimée car le PIB prendrait mal en compte le progrès technologique. Ainsi, la fameuse « stagnation séculaire » du taux de croissance des économies avancées serait due non à une diminution du taux de croissance de la productivité, mais à cette incapacité du PIB de bien capturer l’innovation technologique. La sous-estimation de la croissance est un sujet débattu, mais il n’en reste pas moins qu’une complexification de l’économie poserait de réels défis aux comptables nationaux. La dématérialisation, le renouvellement accéléré des biens et des services, la déconnexion croissante entre prix et valeurs d’usage (dont le cas des services gratuits) ou encore la mondialisation posent de nombreuses problématiques sur le périmètre du PIB, la mesure des niveaux d’activité en volume et la pertinence de la notion de produit « intérieur ». « Les statisticiens utilisent plusieurs méthodes pour contrôler l’évolution de la qualité entre des générations de produits, indique Didier Blanchet. Mais cela reste forcément des mesures approximatives. Ce qu’on appelle les partages volume-prix (distinguer les changements de prix des changements de volumes, NDLR) étaient déjà un problème du temps où l’on ne produisait pas de smartphones. » Pour l’économiste Florence Jany-Catrice, professeure à l’université de Lille, la problématique de l’effet qualité se pose encore plus pour les services, qui représentent 75 % du PIB, que pour le numérique. L’inflation jouant un rôle direct dans la mesure de la croissance économique – la production en valeur est corrigée des effets de l’inflation pour obtenir un indicateur en volume –, « la façon dont l’indice des prix est calculé, c’est-à-dire le moment où les comptables nationaux essaient de distinguer les effets d’inflation des effets quantité et qualité, est cruciale, dit-elle. Or la mesure de la qualité est très délicate pour les services et dépend de conventions qui sont souvent discutables ».
« Les statisticiens utilisent plusieurs méthodes pour contrôler l’évolution de la qualité entre des générations de produits. Mais cela reste forcément des mesures approximatives »
Didier BLANCHET
Directeur des études et synthèses économiques à l’Insee
Se recentrer sur les revenus
En ce qui concerne les effets de la mondialisation – dont l’exemple emblématique est la distorsion du PIB irlandais en 2015 à cause de la relocalisation de profits de multinationales grâce à une fiscalité avantageuse – une piste serait de présenter le PIB sous l’angle du revenu plutôt que sous celui de la production. « Le PIB mesure l’ensemble des revenus qui sont générés sur un territoire donné par l’activité productive. Communiquer ainsi serait plus clair : on comprend, dans l’exemple irlandais, que ce sont les revenus qui ont augmenté et non la production, la question étant ensuite d’isoler les différents types de revenus : les revenus très mobiles des multinationales et les revenus plus stables des ménages résidents, souligne Didier Blanchet. La question du rapport au bien-être s’en trouve clarifiée. Tout le monde sait que l’argent ne fait pas le bonheur, mais tout le monde dit aussi qu’il y contribue. » Ce recentrage sur les revenus des ménages était la première recommandation de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, connue sous le nom de commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, créée sur proposition de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Son rapport, publié en 2009, a marqué une étape importante dans la réflexion sur les limites du PIB. « Ce rapport a donné de la cohérence et de la visibilité à tout un tas de questions sur la pertinence des mesures macroéconomiques, estime Marco Mira d’Ercole. On aurait pu craindre que la crise de 2008 interrompe l’élan, comme dans les années 1970, mais les initiatives se sont poursuivies, surtout au niveau statistique. »
Des indicateurs alternatifs, mais imparfaits
Depuis 2011, l’OCDE publie ainsi un rapport annuel « Comment va la vie ? » et un indicateur du vivre-mieux qui permet de comparer onze dimensions du bien-être (objectives et subjectives) parmi les pays membres de l’organisation et les pays partenaires (4). « Depuis la commission Stiglitz, il y a une véritable ébullition mondiale, notamment de la part des grandes institutions internationales », observe Dominique Méda. « Il se déroule en silence une véritable bataille pour fabriquer le futur indicateur qui remplacera le PIB », juge-t-elle, en citant l’épargne nette ajustée (ENA) de la Banque mondiale, l’indicateur global de richesses (IWI) des Nations unies, le Better Life Index de l’OCDE ou encore l’indicateur de progrès social (Social Progress Index, SPI) (5). Le problème, selon Dominique Méda, est que la plupart de ces indicateurs « n’accordent pas une place suffisante aux questions écologiques et s’inscrivent dans le cadre de la soutenabilité faible, c’est-à-dire que les différents capitaux sont considérés comme substituables ». Par exemple, l’ENA suit l’évolution de la somme de trois capitaux monétarisés (capital économique, capital naturel et capital humain). « L’idée philosophique derrière cet indicateur est effrayante, estime-t-elle. Elle consiste à soutenir que le génie humain est tel que nous pouvons compenser la destruction du capital naturel par notre créativité, que nous sommes en fait capables de construire un monde artificiel qui nous donnera les mêmes doses de satisfaction que le monde naturel. » De fait, pour beaucoup, la plupart des indicateurs alternatifs de richesse présentent des manques. Deux grandes approches existent : les indicateurs synthétiques, qu’ils reposent ou non sur une monétarisation, et les tableaux de bord, qui consistent à regarder un éventail d’indicateurs différents. « Les indicateurs synthétiques présentent un certain nombre de limites, dont la substituabilité et la pondération des différents objectifs, et restent difficiles à lire puisqu’ils agrègent des dimensions très hétéroclites », estime Vincent Aussilloux, chef du département économie-finances de France Stratégie. Pour Didier Blanchet, l’ENA constitue quand même « un bon indicateur de soutenabilité, qui permet de voir si ce que l’on lègue aux générations suivantes est supérieur ou inférieur à ce dont on a hérité de nos parents. Mais le fait que l’indicateur soit positif n’est pas une condition suffisante de soutenabilité et il importe de regarder les évolutions poste par poste. » Selon lui, les tableaux de bord peuvent présenter l’inconvénient d’être « pléthoriques, comme les 232 indicateurs de développement durable de l’ONU. La solution intermédiaire consiste à ne garder qu’une dizaine d’indicateurs mais, dans ce cas, ces tableaux se contentent de remettre sur une seule page des mesures déjà bien connues et consultées ». C’est l’approche d’un tableau de bord restreint qui a été retenue en France à la suite de la loi Eva Sas de 2015 (6). Cinq ans plus tard, le bilan est « mitigé », d’après Vincent Aussilloux. « Les gouvernements successifs ont continué de publier le rapport annuel faisant le bilan de ces dix indicateurs, malgré le changement de majorité. Mais on peut regretter que ces indicateurs ne soient pas devenus la métrique de la qualité de la croissance et qu’ils n’aient pas été intégrés lors de l’évaluation des politiques publiques. » Pour Dominique Méda, il s’agit même d’un « échec lamentable », la loi ayant été « complètement détournée de son sens ». Éloi Laurent préconise de son côté de « caler le rapport prévu par la loi Sas sur le débat budgétaire, et surtout (d’en) confier la rédaction à une instance collégiale tripartite (parlementaires, experts, citoyens) ». « Les représentants de la nation doivent absolument disposer d’un état des lieux élémentaire des inégalités sociales », développe-t-il dans son livre, regrettant que le débat budgétaire français soit aujourd’hui « prisonnier de l’impératif de croissance et de la discipline européenne ». Comme l’ont montré les travaux de Thomas Piketty et de ses collègues du consortium indépendant World Inequality Database (WID) (7), il y a eu un fort accroissement des inégalités depuis les années 1980-1990, mais celui-ci est invisible si l’on s’attache à regarder la seule croissance du PIB. Aux États-Unis, un projet de loi a d’ailleurs été déposé par le leader de l’opposition démocrate pour adjoindre au PIB des données sur les inégalités (répartition des revenus entre chaque décile et les 1 % les plus riches) (8).
« Les indicateurs synthétiques présentent un certain nombre de limites, dont la substituabilité et la pondération des différents objectifs, et restent difficiles à lire puisqu’ils intègrent des dimensions très hétéroclites »
Vincent AUSSILLOUX
Chef du département économie-finances de France Stratégie
PIB : l’éternelle boussole des politiques publiques ?
« Avec la multiplication des indicateurs alternatifs, même s’il reste du travail au niveau statistique, le questionnement se déplace sur leur utilisation concrète dans la sphère politique. La démarche la plus accomplie dans ce domaine est celle de la Nouvelle-Zélande, qui est partie d’un nombre limité d’objectifs, tels que la réduction de la pauvreté infantile, pour bâtir son premier budget du bien-être », relève Marco Mira d’Ercole. Dans un avis adopté début 2020, le Comité économique et social européen (CESE) recommande de s’inspirer de l’expérience néo-zélandaise au niveau de l’Union européenne et de mettre en œuvre une « approche préventive dans laquelle la stabilité macroéconomique ne dépend pas de la croissance du PIB (9) ». De fait, la dépendance des systèmes économiques, fiscaux et sociaux à la croissance du PIB a été identifiée par certains – notamment l’économiste britannique Tim Jackson, auteur de Prospérité sans croissance (10) – comme l’une des raisons de la focalisation persistante sur cet indicateur et l’un des obstacles à lever pour aller au-delà. « Ces systèmes pourraient fonctionner sans croissance, estime quant à lui Antonin Pottier, maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Mais cela demanderait des taux de prélèvements plus élevés. La croissance agit donc comme une sorte de lubrifiant, elle donne des marges de manœuvre et permet d’éviter des arbitrages budgétaires politiquement difficiles. » Pour Antonin Pottier, l’omniprésence du PIB dans le débat public s’explique par un élément, déjà identifié (11) mais souvent oublié, à savoir que « la puissance d’un pays repose encore en grande partie sur la force de l’économie, mesurée par le PIB ». « Les politiques publiques ne poursuivent pas uniquement le bien-être des citoyens mais aussi d’autres objectifs, dont la puissance », souligne-t-il. Selon Florence Jany-Catrice, « la force de rappel du PIB s’explique plutôt par l’incapacité institutionnelle du champ des économistes à être dans l’innovation radicale et par les intérêts économiques qui n’œuvrent pas en faveur de systèmes de production et de consommation qui soient soutenables ».
« Avec la multiplication des indicateurs alternatifs, même s’il reste du travail au niveau statistique, le questionnement se déplace sur leur utilisation concrète dans la sphère politique »
Marco MIRA D’ERCOLE
Chef de la division statistiques auprès des ménages et mesure du progrès à l’OCDE
Une dangereuse focalisation sur la croissance ?
Si le PIB reste central, c’est aussi parce que, pour beaucoup, il est toujours pertinent. « Le PIB est une métrique très importante pour évaluer le niveau de l’activité économique. Personne à l’OCDE ne dit le contraire mais il ne faut pas l’utiliser pour des usages qui ne sont pas les siens », indique Marco Mira d’Ercole. « Il est vrai que le PIB attire beaucoup l’attention et il a de bonnes raisons de le faire. Avec la crise du coronavirus par exemple, il est normal de s’interroger sur l’évolution des revenus de l’économie. Mais nous ne sommes pas non plus dans un régime de dictature du PIB, où les politiques économiques auraient comme seul objectif sa maximisation », opine Didier Blanchet.
« La force de rappel du PIB s’explique par l’incapacité institutionnelle du champ des économistes à être dans l’innovation radicale »
Florence JANY-CATRICE
Économiste, professeure à l’université de Lille
Pour d’autres, le PIB est néfaste en ce qu’il induit une focalisation sur sa croissance. « Le PIB est un indicateur non seulement très limité, mais très dangereux. Vous pouvez avoir un gros taux de croissance et une société dont la cohésion sociale et le patrimoine naturel sont détruits, argumente Dominique Méda. Le PIB concerne un petit canton du réel. Il ne doit pas constituer l’alpha et l’oméga de nos mesures. Nous devons changer de mesures ou du moins encadrer le PIB de deux autres indicateurs majeurs : l’empreinte carbone et l’indice de santé sociale, qui permet de mesurer les inégalités en oeuvre sur un territoire. » Antonin Pottier doute quant à lui qu’un simple remplacement du PIB par d’autres indicateurs puisse être vecteur de transformations sociales étant donné que la croissance est surtout le résultat d’une myriade d’actions des agents de l’économie. « Les champs de réflexion sont assez segmentés, regrette-t-il. La critique du PIB est surtout pensée au niveau macro et le lien n’est pas assez fait avec le comportement des acteurs privés. » La chaire comptabilité écologique, créée début 2019, vise justement à développer ce lien (12). « Le PIB est directement relié à la comptabilité d’entreprise. Modifier les indicateurs de richesse au niveau macro n’a de sens que si on modifie aussi les indicateurs au niveau micro », affirme Alexandre Rambaud, coresponsable de cette chaire. « Contrairement aux indicateurs basés sur une valorisation, comme l’ENA, nous défendons une approche par les coûts : plutôt que de s’interroger sur la valeur d’un écosystème, il faut utiliser des indicateurs biophysiques de stock puis déterminer les coûts nécessaires pour garantir la protection de cet écosystème, qui doivent être pris en compte dès le niveau des entreprises », explique Alexandre Rambaud, chercheur associé à l’université Paris-Dauphine. « Au niveau macro, cela a deux implications : corriger le PIB non pas par de la destruction de valeur, mais par les coûts réels de préservation écosystémique et de préservation sociale, et avoir une réflexion bilancielle, à côté de la réflexion en flux. In fine, le but est d’avoir une comptabilité qui mette en valeur les enjeux afin que les différents acteurs puissent débattre d’une grande question politique : à quoi tient-on ? »
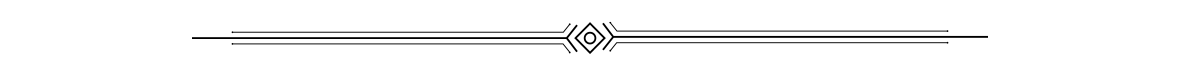
Notes et éclairages
1. Sortir de la croissance. Mode d’emploi, Les liens qui libèrent, 2019.
2. Capital et idéologie, éditions du Seuil, 2019.
3. Par exemple : introduction dans le périmètre du PIB de services rendus par les administrations publiques en 1977, modification du traitement des dépenses de R&D en 2014 et introduction des recettes issues du trafic de drogue en 2018.
4. La comparaison se fait selon le poids que chaque internaute accorde aux onze dimensions. oecdbetterlifeindex.org
5. socialprogress.org
6. Les indicateurs retenus sont les suivants : taux d’emploi des 15-64 ans, dépenses de recherche, dette publique, espérance de vie en bonne santé, satisfaction dans la vie, inégalités, taux de pauvreté en conditions de vie, sorties précoces du système scolaire, empreinte carbone, artificialisation des sols.
7. wid.world
8. Measuring Real Income Growth Act of 2019.
9. Avis d’initiative du CESE, L’Économie durable dont nous avons besoin, adopté en session plénière le 23 janvier 2020.
10. De Boeck Supérieur, 2e édition, 2017.
11. Les Comptes de la puissance : histoire de la comptabilité nationale et du plan, François Fourquet, Éditions recherches, 1980.12
12. chaire-comptabilite-ecologique.fr