Résoudre tous les dysfonctionnements des villes grâce au numérique, c’est la promesse de la smart city. Cet idéal pose pourtant une multitude de questions technologiques, mais aussi démocratiques.
L'actuariel 33 - Juin 2019
En 2050, deux personnes sur trois habiteront en zone urbaine. Le monde comptera alors 2,5 milliards de citadins supplémentaires, selon les projections du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Un afflux de population qui confronte la ville à de nouveaux défis et lui impose de se transformer.
Et si l’avenir résidait dans la smart city ? Grâce à la maîtrise des données numériques, elle propose d’optimiser le fonctionnement de la ville tout en garantissant un développement durable et en favorisant la participation des citoyens. Un idéal mais aussi un marché, dont se sont emparés, notamment, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Les dépenses mondiales dans les programmes de villes intelligentes atteindront 95,8 milliards de dollars en 2019, soit une progression de 17,7 % par rapport à 2018, selon les prévisions d’International Data Corporation (1). La ville est donc un lieu de convoitise que se disputent les acteurs publics et les acteurs privés.
Une ville plus durable ?
L’objectif originel de la smart city était d’améliorer la consommation énergétique des villes. « Elle était le cheval de Troie d’IBM pour entrer dans le secteur de l’énergie », raconte Yasser Wahyuddin, doctorant EVS-Rives à l’École nationale des travaux publics de l’État. Mais la ville plus durable s’appuie désormais plus largement sur une meilleure gestion des ressources et des déchets. « Grâce à des capteurs, nous pouvons détecter les fuites d’eau sur le réseau, mieux maîtriser la consommation et superviser la qualité de l’eau que nous consommons. Notre vision, c’est que la smart city doit être au service de l’homme et fournir des services utiles au plus grand nombre », explique Xavier Mathieu, directeur général de Birdz, entreprise spécialisée dans les solutions connectées pour la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets. Selon le rapport du McKinsey Global Institute (2), grâce au déploiement de capteurs, le gaspillage d’eau dû aux fuites pourrait être réduit de 25 %.
Le remède pourrait-il être pire que le mal ? Certains experts s’inquiètent de l’empreinte environnementale de la smart city et pointent le gâchis énergétique du numérique. Selon le Réseau de transport d’électricité (RTE), la consommation d’électricité des data centers français en 2015 s’élevait déjà à environ 3 TWh, c’est-à-dire une consommation d’électricité supérieure à celle d’une ville comme Lyon. « Les solutions que nous mettons en œuvre, comme le télérelevé de compteurs, ont une empreinte carbone, nous ne le nions pas. Mais les bénéfices sont bien supérieurs au coût énergétique », estime Xavier Mathieu. « Le concept de smart city s’est au début déployé sur des constats : la raréfaction des ressources énergétiques et la densification des villes. Grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement urbain, il est possible de diminuer l’empreinte carbone de la ville. Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des technologies qui vont faciliter des usages à faible empreinte carbone. L’objectif est vraiment de les développer de manière intelligente : quelle technologie est déployée, à quel endroit et pour quel objectif ? C’est pour cela qu’un territoire doit établir une stratégie smart city qui prenne en compte la consommation des ressources, les usages des citoyens, le type de technologies, et qu’il doit également être conscient de l’engagement qu’implique le déploiement de technologies d’une durée de vie de dix ans », affirme Marie Bourget-Mauger, Project Manager Smart Building & IoT chez Axians et doctorante en architecture.
« Les solutions que nous mettons en œuvre ont une empreinte carbone, nous ne le nions pas. Mais les bénéfices sont bien supérieurs au coût énergétique »
Xavier MATHIEU
Birdz
Répondre à des enjeux de santé publique
La smart city s’attaque aux nuisances environnementales auxquelles est exposé le citadin. Environ 91 % des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne quelque 7 millions de décès prématurés chaque année, selon l’OMS. Certaines villes misent donc sur les objets connectés pour surveiller la qualité de l’air et prendre des mesures préventives. « Nous avons installé des capteurs à Eindhoven, aux Pays-Bas, afin de cartographier la pollution urbaine et mettre en évidence les corrélations entre les pollutions (CO2 et allergènes), les déplacements des citoyens et la santé publique. Ces informations viennent nourrir un laboratoire de recherche », détaille Marie Bourget-Mauger. « La ville est cartographiée en temps réel. Ainsi, les habitants peuvent adapter leurs déplacements pour éviter les zones de pollution élevée. La qualité de l’air est un sujet extrêmement sensible pour les villes. Elles ont besoin d’avoir des informations factuelles pour trouver des réponses à ces problèmes de santé publique », complète Édouard Henry-Biabaud, Business Development Manager chez Axians. Mais lutter contre la pollution de l’air s’avère difficile quand le trafic automobile ne dépend plus seulement du politique. « La ville de Montréal a hésité entre le développement de sa propre application d’aide à la navigation pour les automobilistes ou se tourner vers Waze », indique Stéphane Roche, ingénieur, géographe et directeur de la recherche et des affaires académiques de l’Institut national de la recherche scientifique québécois.
En effet, Waze ne prend pas en compte la présence d’une école ou d’un hôpital lorsqu’il redirige les automobilistes. Aux États-Unis, un mouvement de protestation a vu le jour. Certains quartiers ont développé une signalétique anti-Waze et ont fait pression sur leur municipalité pour l’interdire. « Avec ces applications, la ville perd le contrôle de ce qu’elle peut faire, elles ont un effet sur la dynamique, les mobilités urbaines. C’est une sorte d’ingérence indirecte », juge Stéphane Roche. « Nous sommes aujourd’hui dans une confrontation entre l’espace virtuel et l’espace réel, les collectivités locales ont été déstabilisées. Pourtant un maire a énormément de pouvoir : il peut réguler la logistique urbaine, interdire certains véhicules à certaines heures. Certaines villes réagissent en expulsant Uber. D’autres développent des offres pour faire face aux géants du numérique. Lyon, par exemple, a créé Optimod, un système qui permet de choisir son mode de transport et qui se présente comme le pendant de Google Maps », souligne Jean Haëntjens, économiste et urbaniste. La voiture autonome, promue par Google et Apple, pourrait elle aussi devenir un cauchemar pour la mobilité urbaine. « La bulle autour de la smart city est en train de se dégonfler. La voiture autonome ne résoudra pas le problème de la circulation dans les villes et va plutôt le compliquer. Il faut installer des capteurs sur tous les trottoirs et modifier les infrastructures urbaines pour la faire fonctionner. Pour l’instant, les États poussent les constructeurs automobiles dans cette course technologique. Mais ils ont énormément de mal à trouver des terrains d’expérimentation urbains. Quelle ville a intérêt à s’endetter et à se trouver confrontée aux incertitudes réglementaires ? », tranche Jean Haëntjens.
À qui appartient la ville ?
Les grands acteurs du numérique sont les maîtres de la donnée. Mais sont-ils aussi les maîtres de la ville ? Pour Jean Haëntjens, les géants du numérique veulent gouverner nos villes, pour reprendre le titre d’un de ses ouvrages. « Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui qu’il y a une domination des systèmes urbains par le numérique. Mais deux logiques s’affrontent : la logique de la cité politique avec un maire élu par des citoyens, qui propose un projet de société à long terme et, de l’autre côté, la ville as a service, où l’intérêt général ne compte pas, où c’est Waze qui vous dit comment aller d’un point A à un point B. Tout le contraire de l’esprit collaboratif. C’est une ville qui fonctionne comme un supermarché ou le site d’Amazon : vous commandez les services en trois clics et la notion de collectif est complètement dissoute, c’est cela le danger », estime l’auteur.
Les plateformes numériques transforment néanmoins le territoire en profondeur. Alphabet, la holding créée en 2015 pour réunir les sociétés précédemment détenues par Google, n’hésite pas à se lancer dans des projets spectaculaires. Sa filiale Sidewalk Labs construit un quartier de 325 hectares à Toronto. « C’est une entreprise privée américaine qui investit et décide du design urbain. La question est de savoir jusqu’à quel point les entreprises privées vont influer sur les choix des villes », observe Stéphane Roche. « Garder la main sur l’espace public est fondamental. Certaines villes passent aujourd’hui des contrats avec des groupes privés pour le gérer. C’est le cas de Londres, où il existe une cinquantaine de private owned public spaces, c’est-à-dire des espaces publics qui sont détenus par des groupes privés. En contrepartie d’un loyer ou d’une concession, ils installent des publicités ou exploitent ces espaces », constate Jean Haëntjens. Une des clés des villes pour conserver la maîtrise de leur territoire est de posséder des compétences techniques en interne. « Des citoyens ont attaqué la ville de Chicago. La municipalité avait vendu des parkings à des entreprises. En y installant un système de réservation numérique, elles ont doublé la rentabilité des parkings. La municipalité n’avait pas réalisé la valeur de son actif », explique Jean Haëntjens.
Quel que soit le domaine, les datas irriguent la smart city et participent au fonctionnement urbain. Conséquence ? Pour garder le contrôle, les villes se transforment en gestionnaires des données. « Nous pensons qu’il faut un système d’information dédié qui centralise l’ensemble des datas captées. Les corréler, les faire parler, leur donner de la valeur ajoutée et engager des stratégies transversales : c’est cela le défi de demain », indique édouard Henry-Biabaud. Ce nouvel or noir n’a pas qu’une vocation économique. « Dans la smart city, les données ne sont pas forcément monétisées, elles peuvent aussi servir la recherche et le milieu académique », précise Marie Bourget-Mauger. D’ailleurs les données se manipulent avec précaution. « Au sein de la smart city, le RGPD est extrêmement important. Les gestionnaires de la ville ont une vraie responsabilité, ils ne peuvent pas se dédouaner en confiant leur système d’information à un opérateur. La loi pour une République numérique exprime très clairement que les territoires et l’ensemble du secteur public sont responsables de la protection des données privées. C’est l’une des raisons pour lesquelles la ville doit être propriétaire de ces infrastructures de communication », considère Édouard Henry-Biabaud. « Quand la ville déploie une solution smart city, le citoyen va attendre d’elle des services supplémentaires : en plus d’assurer sa sécurité physique, elle devra assurer sa sécurité virtuelle. Le traitement des données devient un service public dont la ville doit garder la gouvernance », insiste Marie Bourget-Mauger.
« Le traitement des données devient un service public dont la ville doit garder la gouvernance »
Marie BOURGET-MAUGER
Axians
Les risques de la dépendance technologique
« Certaines villes françaises ont fait le choix, à un moment, de gérer toutes leurs données avec des solutions technologiques qui semblaient pérennes. Je pense au système d’information géographique développé par la Lyonnaise des eaux. Elle l’utilisait pour gérer les données de réseau, mais en a également fait un business. À un moment, elle a décidé de se recentrer sur son métier. Sans suivi, certaines villes se sont retrouvées dans une situation préoccupante et ont dû passer à une autre solution avec toutes les conséquences qu’implique une migration. Et il ne s’agissait là que d’une seule application. Imaginez que tous les services de la ville soient gérés sur une plateforme… », signale Stéphane Roche. La présence massive de données attise aussi d’autres convoitises. Attaque des services municipaux d’Atlanta, piratage du métro de San Francisco ou de l’aéroport de Bristol… En devenant plus intelligentes, les villes ont accru leur vulnérabilité aux cyberattaques. « À l’ère du tout connecté, il ne s’agit pas de savoir si un jour on va être piraté. Le sujet est de savoir ce qui a été mis en place pour limiter ce piratage. Il est important de concevoir une architecture de sécurité, de mettre en place des technologies pour isoler les données, les protéger, etc., et de prévoir une organisation au sein du territoire pour limiter cet acte de malveillance », développe Édouard Henry-Biabaud. « Nous sommes en train d’intégrer de plus en plus de données de chiffrement dans nos solutions, en utilisant notamment les nouvelles technologies comme la blockchain pour nous assurer de l’intégrité de la donnée qui est transmise », annonce Xavier Mathieu.
Les perspectives offertes par l’intelligence artificielle interrogent également sur le contrôle de la ville sur ses prises de décision. « Beaucoup de réflexions émergent autour de l’intelligence artificielle, en partie sur la question de l’effet boîte noire avec l’apprentissage profond. Avec l’usage de ces technologies, une partie même de la logique sur laquelle les décisions sont prises va nous échapper. C’est un choix de société à mettre au regard du besoin de transparence des citoyens », analyse Stéphane Roche.
Une ville réservée à l’élite ?
Autre promesse de la smart city : repenser la gouvernance de la ville, notamment en encourageant la participation des citoyens. Pour cela, elle s’appuie sur les civic tech, « les technologies citoyennes ». Depuis 2016, le conseil municipal de Barcelone utilise la plateforme Decidim pour construire une ville plus démocratique. Grâce à elle, les habitants peuvent notamment soumettre et voter des propositions de politiques publiques, débattre sur la gestion des infrastructures, établir des budgets participatifs. 9 824 propositions ont été acceptées à ce jour. Mais, en imposant le recours au numérique pour accéder aux services municipaux, ne va-t-elle pas accroître les inégalités ? « C’est la question de la fameuse fracture numérique. Il existe un enjeu de littératie numérique : quelles mesures la ville va-t-elle mettre en place pour contrer la pauvreté informationnelle ? Il me semble qu’il devrait y avoir une responsabilité publique de la ville sur ce point, notamment parce qu’aujourd’hui la ville est l’échelon géographique auquel la majorité des individus se rattachent. Lorsque l’on sait que des décisions vont être prises essentiellement sur la base des données numériques disponibles, si certains quartiers ne sont pas couverts en données numériques pour une raison ou une autre, les décisions pourront-elles être prises avec la même pertinence, la même justesse ? », relève Stéphane Roche. L’inégalité des territoires au sein de la ville pourrait être aggravée par l’implantation des solutions technologiques. La 5G dessine le futur de la smart city. Ce réseau offre un débit plus rapide et une fiabilité accrue. Un atout pour améliorer les services et mieux connecter les infrastructures publiques aux citoyens. Son coût étant encore trop élevé pour la déployer sur l’ensemble d’une ville, les territoires défavorisés risquent, une fois de plus, d’être les derniers servis.
« Aujourd’hui, la géolocalisation est semblable à une rematérialisation de la vie numérique des individus »
Stéphane ROCHE
INRS
La fin de la vie privée ?
Impossible d’être anonyme dans la smart city. Pour alimenter la ville intelligente, la masse de données produites par les différents capteurs doit être importante. Or la plupart d’entre elles ont un caractère qui peut être personnel. La géolocalisation cristallise ainsi les enjeux de la vie privée dans la smart city. « Aujourd’hui, la géolocalisation est semblable à une rematérialisation de la vie numérique des individus. Quand vous vous rendez sur un site Internet, il apprend à connaître vos goûts, ce que vous faites, avec qui, etc. Ce fonctionnement se matérialise désormais dans des centres commerciaux ou des espaces urbains sous la forme d’une personnalisation algorithmique des espaces physiques », décrit Stéphane Roche. Suivre à la trace les citoyens est devenu possible grâce à l’explosion de la vidéosurveillance et à l’émergence de technologies comme la reconnaissance faciale. Parallèlement à la smart city, est apparue la notion de safe city, une ville plus sûre grâce à la technologie. « J’ai travaillé sur un projet pour une ville australienne, qui souhaitait mettre en place un outil automatique pour donner l’alerte. Relié aux caméras, son but était d’analyser le déplacement, la dynamique d’un individu ou d’un groupe par rapport à des normes et de signaler les comportements suspects. La question est de savoir d’où viennent ces normes, qui les a définies. Des dérives possibles existent et ces pratiques soulèvent la question du triage socio-spatial », s’interroge Stéphane Roche.
L’œil de Big Brother
Le marché de la vidéosurveillance est en plein boom. D’ici à 2023, le chiffre d’affaires des vendeurs de matériel, de logiciels et de services de sécurité par la vidéo devrait augmenter à un rythme moyen de 13,1 % par an, d’après une étude de mai 2018 de Markets & Markets. « Les nouvelles technologies de la surveillance sont un énorme business dans un espace hyper concurrentiel, ce secteur industriel n’est jamais en crise car il est soutenu par les États », évalue le sociologue Laurent Mucchielli. Ce spécialiste des politiques de sécurité pointe les résultats minimes offerts par ces technologies. « La ville de Nice consacre chaque année 17 millions d’euros à la vidéosurveillance. C’est la grande ville la plus vidéosurveillée de France : 2 000 caméras, 120 personnes affectées au centre de vidéosurveillance. Pourtant les courbes de délinquance sont les mêmes qu’il y a dix ans. Les citoyens ne sont jamais consultés. Dans les très rares villes où il y a eu du débat public et des référendums locaux, les habitants s’y sont opposés au vu du coût et du peu d’intérêt que présente la vidéosurveillance. »
« Dans les très rares villes où il y a eu un débat public, les habitants se sont opposés à la vidéosurveillance »
Laurent MUCHIELLI
Sociologue
Pourtant certains pays en ont fait un pivot de leur politique sécuritaire. La Chine l’utilise pour appliquer son système de notation de citoyens, qui dépend notamment de leurs comportements dans les lieux publics. Dans cette « société de l’intégrité », les citoyens pénalisés se voient privés du droit de postuler à certains emplois, d’inscrire leurs enfants dans certaines écoles ou encore de prendre les transports. Selon le cabinet d’étude américain IHS Markit, il y avait 176 millions de caméras en Chine en 2016, il est prévu d’en installer 450 millions d’autres d’ici à 2020, la date butoir pour réaliser l’objectif d’un réseau national « omniprésent, entièrement en réseau, toujours opérationnel et entièrement contrôlable » promis dans un document officiel publié en 2015. Le pays ne cesse d’innover en la matière. En avril, le New York Times révélait que le système, couplé à un logiciel de reconnaissance faciale et aux bases de données de personnes surveillées par l’état, était utilisé pour traquer la minorité ouïghour. « Tout est dans les usages que nous humains décidons de faire de la technologie. La Chine est une dictature policière. Dans l’Hexagone, la vidéosurveillance est censée aider à lutter contre la délinquance. En Chine, c’est un outil fondamental de contrôle de la population. En France, il y a un droit qui protège la liberté publique et la vie privée », soutient Laurent Mucchielli. Mais l’inquiétude demeure : l’idéal miraculeux serait-il une dystopie ?
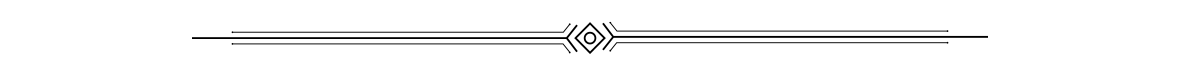 1. « Worldwide semiannual smart cities spending guide », janvier 2019.
1. « Worldwide semiannual smart cities spending guide », janvier 2019.
2. « Smart cities : digital solutions for a more livable future », juin 2018.