Pour figurer dans le top des classements, certaines écoles et universités repensent leurs programmes, leurs méthodes, leurs organisations...
L'actuariel 34
Ces innovations sont-elles vertueuses pour les étudiants et adaptées aux défis de nos sociétés ?
Le chercheur Nian Cai Liu s’attendait-il à mettre le feu aux poudres en créant, un jour de 2003, le classement de Shanghai ? Selon la sociologue Catherine Paradeise, « son but était simplement de comparer les universités chinoises avec les autres institutions du monde. Mais pas de faire perdre la face à tel ou tel pays ! » Toujours est-il que le palmarès produit un grand retentissement. « Les pays européens découvrent que la mondialisation engendre un marché du savoir à grande échelle, où ils risquent de perdre le privilège de former leurs propres élites et les élites du monde, avec tous les risques économiques, politiques et culturels que cela comporte dans la redistribution des cartes mondiales. »
Pour juger la performance des établissements, le classement de Shanghai s’établit autour de six critères, regroupés en quatre domaines : la qualité de l’enseignement, la qualité du corps académique, la production scientifique et la productivité. Sont ainsi comptabilisés le nombre de membres de l’établissement ayant reçu un prix Nobel ou une médaille Fields, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur domaine, et le nombre d’articles publiés notamment dans Nature et Science par les membres du corps académique au cours des cinq dernières années. Enfin, la productivité correspond au score total des cinq premiers indicateurs, divisé par la taille du corps académique de l’établissement.
Plus qu’un outil permettant de cartographier les lieux d’excellence, de nombreux établissements s’appuient alors sur ce système de notation pour guider leur stratégie et améliorer leur positionnement dans le classement. La première publication de Shanghai, « constitue le point de départ d’un véritable marché concurrentiel, avec des entrées et sorties d’opérateurs et la constitution de positions dominantes », note le rapport des ministères de l’Éducation nationale et de l’Économie et des Finances de 2017(1) et encourage le développement d’autres palmarès internationaux. À l’appui d’une enquête réalisée en 2016 auprès de 150 établissements de l’enseignement du supérieur, le même rapport démontre leur influence majeure sur les gouvernances d’établissements français et étrangers : «46 % des établissements interrogés considèrent que leurs stratégies en matière de recherche, de communication (44 %) et de partenariats internationaux (47 %) sont guidées par les classements internationaux. »
Jouer le jeu de la concurrence, au détriment de l’intérêt général ?
Dès sa première diffusion, la principale critique adressée au classement touche à sa mesure quantitative : en jugeant les établissements sur des critères de qualité strictement chiffrables, la complexité de l’enseignement supérieur, l’investissement pédagogique et la qualité des enseignements dispensés ne peuvent être reflétés. « Malgré la connaissance de ce biais, les universités ont joué le jeu de la “politique d’excellence” et ont emboîté le pas aux grandes écoles en développant leurs services de communication pour travailler et valoriser leur “ marque” . Y compris à l’international, car le discours selon lequel le nombre d’étudiants étrangers à recruter est décisif pour rayonner s’est de plus en plus répandu, a constaté Geneviève Verdo, docteure en histoire et maîtresse de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Mais penser que l’université arrivera à concurrencer les grandes institutions internationales est un leurre. D’abord parce que les budgets universitaires ne sont pas à la hauteur des leurs, et ensuite parce que nous évoluons dans un marché mondialisé, où l’on sait qu’on n’égalera jamais Harvard. »
Une position largement contestée par les porteurs de projets de fusions d’établissements, rendues possibles par la loi sur l’autonomie des universités de 2007. L’objectif de ces regroupements : assembler les forces de recherche et les ressources financières pour égaler la force de frappe des universités les plus en vue dans le palmarès de Shanghai. C’est l’une des motivations du projet de l’université Paris-Saclay, qui réunit des établissements publics et privés dont l’université Paris-Sud, CentraleSupelec, l’Ensae, l’École normale supérieure (ENS) Cachan, Paris-Saclay et AgroParisTech, autour de l’École polytechnique. Pour Alain Sarfati, président de l’université Paris-Sud, laquelle a gagné cinq places dans le classement de Shanghai par rapport à 2018 pour se hisser au 37e rang en 2019 : « Le palmarès, de par sa médiatisation, nous offre une visibilité importante, notamment auprès des étudiants internationaux, mais aussi pour nos collaborations, que ce soit avec des entreprises industrielles ou des établissements d’autres pays. C’est un excellent présage pour le classement de la future université Paris-Saclay, qui pourrait entrer directement dans le top 20 des meilleurs établissements dans le monde. » D’autres exemples de fusion montrent pourtant des résultats mitigés en termes de progression dans les classements. L’université Pierre-et-Marie-Curie, classée 40e dans le classement de Shanghai en 2018 avant de fusionner avec Paris-Sorbonne la même année, gagne 4 places avant d’en perdre 8 en 2019. Pierre Mutzenhardt, président de la commission de recherche de la Conférence des présidents d’universités (CPU), tempère ce résultat : « Il s’agit d’une politique à long terme. Si on n’avait rien fait, alors que le reste du monde bouge, nous serions dans une bien plus mauvaise position. » De leur côté, les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Économie et des Finances remarquent que « la fusion d’établissements peut améliorer le positionnement dans les classements internationaux si elle concerne des établissements plutôt homogènes. Lorsque les établissements qui fusionnent le sont moins, les résultats sont plus aléatoires ».(2)
En l’occurrence, pour Pierre Alquier, professeur de statistiques à l’Ensae, l’université Paris-Saclay revêt une forte hétérogénéité. « Ce projet a été monté à la va-vite, a peiné à avancer, notamment en raison des divergences entre établissements publics et privés », observe-t-il. En effet, là où les grandes écoles reprochent le manque de sélection à l’entrée des cursus et l’inertie administrative universitaire – perçue comme un frein aux changements –, les universités dénoncent la sélection drastique et la faible implication des grandes écoles dans la recherche. Bilan de cette fusion, selon Hugo Harari-Kermadec, maître de conférences en économie à l’ENS Paris-Saclay : « Ce sera un établissement avec des étudiants presque tous sélectionnés, focalisé sur le niveau master et doctorat, avec beaucoup plus de recherche et beaucoup moins d’enseignements que dans une université française traditionnelle », déclarait-t-il dans un entretien au Monde en août 2019. « Le but du projet Paris-Saclay était de constituer un “MIT à la française », en attirant des chercheurs étrangers et en produisant des postes que les profs d’université n’occuperaient pas selon les modalités prévues par la grille de l’éducation nationale, renchérit Pierre Alquier. Pour y parvenir, deux possibilités existent : monter des diplômes payants et plus chers qu’avant ou demander à des entreprises privées de financer des chaires. » Une politique qui, selon Hugo Harari-Kermadec, va à l’encontre de l’aspiration revendiquée depuis les Lumières d’instruire le plus grand nombre. « Adapter le système universitaire français au classement de Shanghai, c’est lui faire adopter une logique de concurrence et de rationalisation économique, au détriment de l’esprit de service public et des missions académiques. »
« Adapter le système universitaire français au classement de Shanghai, c’est lui faire adopter une logique de concurrence et de rationalisation économique, au détriment de l’esprit de service public »
Hugo HARIRI-KERMADEC
Maître de conférences en économie à l’ENS Paris-Saclay
Prestige à la demande
Pour s’imposer sur le marché de l’enseignement supérieur, certains établissements ont choisi de miser sur les moocs (massive open online courses). Initiés par plusieurs universités américaines tels le MIT et Harvard, ces cours en ligne ouverts et massifs se sont développés dès les années 2000. Dans l’Hexagone, les premières plateformes émergent en 2013, à la suite de la mise en place de France Université numérique (Fun), la plateforme de moocs créée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Selon Frank Ziegele, chef de projet du classement U-Multirank, ces enseignements pourraient rebattre les cartes du jeu concurrentiel entre les établissements. « Jusque-là, l’un des outils principaux de la compétition était le programme. Les élèves allaient à Sciences Po pour bénéficier de tel ou tel contenu d’enseignement et de sa réputation, avance-t-il. À l’avenir, le parcours des étudiants pourrait s’apparenter à un shopping de différentes institutions. Ils pourraient par exemple suivre un mooc d’Harvard et y obtenir un certificat, tout en suivant la formation d’une université française qui leur délivrerait également un diplôme. » Un phénomène qui aurait des retombées aussi positives que négatives sur le prestige des universités : « Si cela peut permettre aux moins reconnues de faire rayonner leur marque à l’échelle internationale, les plus prestigieuses, à l’inverse, mettraient la leur en danger en rendant accessible ce qui était réservé à certains », ajoute-t-il. Geneviève Verdo relève pour sa part deux inconvénients majeurs à l’expansion des moocs : un enseignement standardisé, ainsi qu’une difficulté à articuler massification et suivi individuel. « S’ils se développent dans une logique élitiste, on peut imaginer un monde où seuls quelques cours par discipline seraient dispensés par une poignée de professeurs de renom, et suivis par des milliers d’élèves de la planète. Le risque, par ailleurs, est de faire exploser la notion même d’établissement. Dans le cas où les moocs seraient vus comme une formation à part entière, équivalents aux cours en présentiel, que resterait-il de la relation élève-enseignant ? »
« Si les moocs se développent dans une logique élitiste, on peut imaginer un monde où seuls quelques cours seraient dispensés par une poignée de professeurs de renom, et suivis par des milliers d’élèves de la planète »
Geneviève VERDO
Docteure en histoire et maîtresse de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vers d’autres modes de classement ?
Un autre critère quantitatif permettant de hiérarchiser les établissements est largement discuté : la rémunération des alumni. « La plupart des classements notent les universités en fonction de la progression salariale de leurs élèves. De fait, les écoles les mieux notées sont celles dont les étudiants se destinent à la finance et au conseil », souligne le rapport Business School Rankings for the 21st century de l’UN Global Compact(3), paru en 2019. L’importance accordée à ce critère influe-t-elle pour autant le choix d’orientation des étudiants ? Pas selon Pierre Alquier : « Je pense que les étudiants prêtent peu d’attention aux classements et ont intégré que les critères n’étaient pas les bons. » « Aujourd’hui, les étudiants ne voient plus leur future carrière comme un simple moyen de gagner leur vie, mais comme l’opportunité de jouer un rôle dans un projet de société qui a du sens pour eux, complète Clémence Vorreux, chargée de mission affaires publiques au sein du think tank The Shift Project. S’ils veulent attirer les meilleurs élèves, les établissements se rendront bientôt compte qu’il n’est plus stratégiquement viable de miser sur ce type de critères. » Pour corriger ce biais, le classement alternatif U-Multirank, initié par la Commission européenne, est mis en place en 2014. Frank Ziegele, son chef de projet, explique : « Le constat de départ était que les classements existants ne font pas apparaître toutes les dimensions de la performance : un établissement peut être excellent en termes de recherche, quand un autre peut se démarquer par sa forte interaction avec le tissu économique régional, expose-t-il. L’idée était alors de refléter cette diversité d’établissements pour aider les étudiants à s’orienter vers celui qui réponde à leurs aspirations professionnelles.» Cinq grandes dimensions sont ainsi prises en compte : la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage – mesurées à l’aide d’indicateurs d’employabilité – l’ouverture sur l’international, le nombre de contrats passés avec les entreprises, l’insertion dans le territoire et la contribution de l’établissement à la croissance économique de celui-ci. Malgré sa volonté de singularité, U-Multirank, pour beaucoup, a le défaut de sa qualité : « Devant couvrir l’immense diversité du champ mondial de l’enseignement supérieur, le principal frein est le temps. Car le classement requiert de la part des institutions un véritable arsenal statistique, résume le rapport des ministères de l’éducation nationale et de l’économie et des finances. Ces difficultés font qu’U-Multirank intéresse finalement peu les établissements d’enseignement supérieur français. »
Dans son rapport, l’UN Global Compact dresse un autre constat : « Bon nombre des critères actuellement utilisés par les classements ont été élaborés il y a des années ou des décennies. » Or, si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’ajustements significatifs depuis leur élaboration, les défis de l’enseignement supérieur, eux, se transforment : de nouveaux métiers sont appelés à se créer au cours des prochaines années, la révolution technologique se poursuit et les enjeux climatiques induiront des changements dans de nombreuses pratiques professionnelles. Par anticipation, les établissements sont toujours plus nombreux à mettre sur pied des spécialisations portant sur la robotique, le data mining, la biotechnologie ou encore l’intelligence artificielle (IA). En 2018, l’école de commerce Skema s’est engagée aux côtés de Microsoft afin de « contribuer à faire de la France la nation de l’IA » en créant un double diplôme avec une école d’ingénieurs. La même année, l’École polytechnique s’est associée à Google France pour monter une chaire internationale d’enseignement et de recherche dans le domaine de l’IA. « À Paris-Dauphine, un module d’enseignement sur les nouveaux modes de travail a également été inclus. Cela démontre un effort de la part des établissements pour anticiper les évolutions du monde de l’entreprise », affirme Aurore Haas, enseignante à Skema et maîtresse de conférences à l’université Paris-Dauphine.
«Pour être visibles à l’échelle internationale, les établissements du supérieur ont observé quels étaient les domaines d’enseignement valorisés par les principaux palmarès et ont tenté de s’aligner, quitte à gommer leur spécificité »
Pierre ALQUIER
Professeur de statistiques à l’Ensae
Préparer les étudiants aux transitions
Selon Pierre Alquier, ces initiatives ne sont toutefois pas étrangères à la stratégie de progression dans les classements. « Pour être visibles à l’échelle internationale, les établissements du supérieur ont observé quels étaient les domaines d’enseignement valorisés par les principaux palmarès et ont tenté de s’aligner, quitte à gommer leur spécificité. Cela a amené certaines écoles avec une forte image de marque à intégrer ces cours dans leurs programmes de peur d’être pénalisées et de baisser durablement dans les classements, explique-t-il. C’est le cas, par exemple, de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Supaéro), qui a intégré des cours de finance dans son programme, alors que ce n’est pas forcément en adéquation avec son identité. Ce phénomène d’imitation a conduit à une certaine uniformisation des formations. » Philippe Mérigot, maître de conférences à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et auparavant à l’Inseec, perçoit également la mise en avant de ces spécialités comme un opportunisme. « Après la crise financière et des subprimes, la tendance était aux cours “d’éthique de la finance”, observe-t-il. Aujourd’hui, on observe le même phénomène avec le big data ou l’intelligence artificielle. En regardant de plus près, on s’aperçoit que ces thèmes sont abordés de manière transversale ou optionnelle, à défaut d’un enseignement à part entière. »
D’autres spécialisations peinent davantage à s’inscrire dans le paysage du supérieur. Les enjeux liés au climat et à l’énergie restent ainsi un enseignement minoritaire, malgré une forte demande de la part des étudiants. « Aujourd’hui, sauf quelques exceptions, les palmarès ne valorisent pas les établissements pionniers en matière d’enseignement des enjeux climatiques. Il est donc peu stratégique pour une école de les intégrer, voire nuisible pour leur prestige », déplore Clémence Vorreux, co-auteure du rapport Pour l’avenir de l’enseignement supérieur du think tank The Shift Project. Ainsi, à l’heure actuelle, seules 11 % des formations post-bac abordent ces thématiques. Parmi les établissements qui les dispensent, 50 % sont des écoles de commerce ou d’ingénieurs et uniquement 8 % sont des universités. « La plus grande flexibilité des écoles de commerce et d’ingénieurs en termes d’organisation de leurs programmes explique cet écart, souligne Clémence Vorreux. Les universités, soumises à un référentiel national, sont plus contraintes. Il est plus long d’y intégrer des changements, et de recruter des enseignants qui travaillent sur de nouvelles problématiques. » Pour inverser la tendance, selon elle, le rôle de l’État est décisif. « Il y a quelques années, celui-ci a rendu obligatoire la fonction de vice-président numérique dans toutes les universités. Cela a contribué à mettre le numérique sur le devant de la scène. Pourquoi ne pas copier le modèle, en nommant un “directeur de la transition” pour développer l’enseignement des enjeux climat-énergie ? »
« Il y a une vraie valeur ajoutée à s’appuyer sur la culture générale. D’autant que les carrières ne sont plus aussi linéaires qu’avant et que l’on ignore quels métiers seront créés dans quelques années »
Aurore HAAS
Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine
Faut-il favoriser l’hyper-spécialisation ?
Mis au défi de former les étudiants à de futurs métiers dont les contours demeurent flous, les établissements peuvent avoir des difficultés à se positionner, observe Aurore Haas. « D’un côté, il est demandé d’avoir des compétences techniques de plus en plus sophistiquées et, de l’autre, il faut permettre aux étudiants d’avoir une vision et des compétences assez larges pour qu’ils s’adaptent aux futurs besoins du marché de l’emploi », résume-t-elle. Faut-il donc favoriser l’hyper-spécialisation ? Ou au contraire miser sur un renforcement des savoirs fondamentaux ? Clémence Vorreux, elle, craint un développement insuffisant des spécialisations : « Dans les écoles, les nouveaux enjeux sont souvent abordés de manière optionnelle. Un étudiant en finance peut par exemple choisir une spécialité “enjeux climatiques”, sans qu’elle soit nécessairement appliquée à la finance. Or, à l’avenir, les entreprises devront sûrement se battre pour avoir un directeur financier qui ait des compétences très spécifiques lui permettant de gérer le risque des actifs échoués et d’être au point sur les nouvelles réglementations… » Pierre Alquier se montre plus confiant : « À l’Ensae, nous formons des gens qui ont un bagage scientifique suffisamment solide pour être capables d’apprendre de nouvelles choses lorsqu’il y a un besoin d’évolution. Un étudiant qui a suivi des cours de statistiques avancées, de mesure de risques, est en mesure de s’adapter si une entreprise lui demande du jour au lendemain de prendre en compte le risque climatique. » Aurore Haas voit également « une vraie valeur ajoutée à s’appuyer sur la culture générale. D’autant que les carrières ne sont plus aussi linéaires qu’avant et que l’on ignore quels métiers seront créés dans quelques années. » « Sans cette culture générale, il est difficile d’avoir une vision évolutive du monde, de relier les faits à d’autres domaines dans une vision universelle. Le risque de l’hyper-spécialisation, c’est de cocher, un peu bêtement, des cases de compétences », avançait Maurice Thévenet, délégué général de la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) dans un entretien à L’Essentiel du sup en 2018.
Le débat n’a toutefois rien de récent puisqu’il interroge la finalité même de l’enseignement. Montaigne ne disait-il pas déjà en son temps qu’une tête bien faite valait mieux qu’une tête bien pleine ? Un questionnement qui traverse également les travaux du sociologue et philosophe Edgar Morin, pour qui l’important est non pas l’accumulation des savoirs, mais bien de disposer d’une aptitude générale à poser et à traiter les problèmes, permettant de relier les savoirs et de leur donner du sens.
 Classement de shanghai
Classement de shanghai
La technique d’agrégation est-elle mathématiquement déficiente ?
Dans le cadre de leur publication Faut-il croire le classement de Shanghai ? Une approche fondée sur l’aide multicritère à la décision de 2010, les chercheurs Jean-Charles Billaut, Denis Bouyssou et le mathématicien Philippe Vincke décryptent la technique d’agrégation utilisée pour établir le classement de Shanghai.
« Dans tout cours d’introduction au multicritère, on enseigne le fait que, si l’on agrège plusieurs critères en utilisant une somme pondérée, les poids utilisés ne doivent pas être interprétés comme s’ils reflétaient “l’importance” des critères », expliquent-ils. En effet, s’il est possible d’utiliser deux critères exprimés dans différentes mesures au sein d’une somme pondérée, ces poids ne peuvent être utilisés comme s’ils reflétaient « l’importance » des critères, au risque de produire un résultat absurde. Par ailleurs, dans le cas d’un changement de la normalisation des critères, une modification des poids s’impose afin de refléter cette modification. « Dans la mesure où tous les ans, les auteurs du classement normalisent les critères en donnant le score de 100 à la meilleure institution pour chaque critère, et dans la mesure où tous les ans, le score non normalisé de la meilleure institution change, les poids devraient changer tous les ans de manière à refléter cette nouvelle normalisation », notent les chercheurs. Or, d’une année à l’autre, les auteurs du classement ne changent pas les poids pour refléter ces changements de normalisation.
« Autrement dit, le classement est relatif au score du meilleur établissement, précise Jean-Charles Billaut à L’Actuariel. Si celui-ci améliore son score l’année suivante, dans la mesure où les poids n’évoluent pas, la position relative des autres établissements est modifiée. En aucun cas alors on ne peut conclure que “s’améliorer sur un critère” permet à un établissement de monter dans le classement. C’est un paradoxe mathématique, dans le sens où le résultat conduit à une solution paradoxale. La méthodologie a sensiblement changé depuis 2010, mais ce biais existe toujours en 2019, confirme-t-il. Ainsi, dire que le 54e établissement est meilleur que le 56e n’a aucun sens. En revanche, dire que celui qui se situe dans la tranche 200-300 est meilleur qu’un établissement de la tranche 300-400 commence à être entendable… »
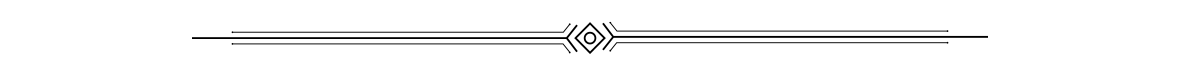 1 et 2 – « La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site » ministères de l’Éducation nationale et de l’Économie et des Finances, 2017.
1 et 2 – « La prise en compte des classements internationaux dans les politiques de site » ministères de l’Éducation nationale et de l’Économie et des Finances, 2017.
3- Initiative des Nations unies lancée en 2000 dont le but est d’inciter les entreprises du monde à adopter une attitude socialement responsable.